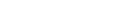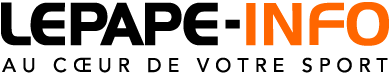Jeudi 19 mars. Je me réveille bien plus tôt que d’habitude, l’esprit vif. Les doigts tremblotants se posent avec délicatesse sur mon front. Les oreilles pareilles au stéthoscope se nichent au cœur de la poitrine : elles y guettent le moindre tressaillement, à l’image de la bête qui scrute les moindres bruissements du feuillage à la recherche de sa proie.
Puis je pilonne de questions ma copine, semblable au marteau piqueur qui fracture le sol. La fièvre ne trace plus ses sillons dans son cortex, c’est déjà cela.
C’est devenu un rituel, tous les matins depuis deux jours.
C’est fou comme chacun est devenu son propre médecin. Je suis certain, désormais, d’avoir contracté le Covid-19, virus invisible, virus impalpable dont le nom barbare résonne comme une arme de guerre.
Un des sociologues interviewés la semaine précédente lors d’un reportage à Liverpool me l’a probablement transmis. Il est, depuis, secoué par de violentes douleurs.
Chacun est son propre médecin
Ce qu’il y a « d’intéressant », c’est d’observer la réaction de ses proches. Une certaine forme d’affolement, pour certains, quand bien même 80% des personnes touchées présentent des formes bénignes de la maladie et en guérissent sans problème. C’est toutefois, loin d’être, la bonne grippe seriné ici et là en janvier et février.
Bon, j’avoue que j’ai eu quelques heures agitées, dans les entrelacs de mon cerveau tempétueux.
Je lis avec frénésie une foultitude d’article sur la question, et certains témoignages sont effrayants.
Ce doit être humain, mais on trace vite un parallèle avec sa propre condition : si la légère brûlure qui a parcouru ma poitrine pendant trois jours s’est dissipée le mardi 17, je redoute de la seconde phase. J’ai été, vraisemblablement, contaminé le 11 mars. La période d’incubation est de 14 jours.
Les 6, 7 jours qui arrivent vont être longs. Serais-je tranquillement dans mon canapé, dans une semaine ? Sous respirateur artificiel ? En train de composer, en sueur et depuis des heures, le numéro de la NHS (l’équivalent du 15 en France), saturé ? Et la France, dans quel état sera-t-elle ? Et l’Italie ? Et l’Angleterre ?
Je compte fébrilement les jours comme le gamin coche les cases de son calendrier de l’Avent, jusqu’à Noël. Au bout du compte, le cadeau de la vie.
Minerai salvateur
Je me résous donc à stopper la course à pied – l’Angleterre n’était alors pas confinée, c’est le cas depuis lundi 23 mars au soir ; les écoles, pubs et restaurants ont fermé vendredi 20, mais il était loin d’être rare d’en trouver ouverts le week-end dernier, de même que moult commerces non essentiels.
Chaque matin, après l’ersatz d’auscultation, les mains, robotiques fouettent l’air à la recherche du téléphone portable. Un coup d’œil sur Whatsapp pour vérifier que la famille va bien. Et vite, un clic pour se rendre sur le live du Monde , puis sur la chronique quotidienne de Daniel Schneidermann sur Arrêts sur Images (que je vous recommande) pour s’enquérir des nouvelles de la planète. On lit ici et là –et j’en suis persuadé- que la gangue de confinement contient son minerai salvateur. Un moment de reconnexion à soi-même, à son corps, à son esprit. Encore faut-il le vivre, plutôt que de l’espérer telle la prophétie autoréalisatrice.
Pour l’instant, je suis surtout relié aux réseaux sociaux. Les écrans comme un troisième œil, sur le monde, sur la France, sur le village où vivent mes parents.
Comment faisaient-ils dans les années 1940, sans Internet, sans nouvelles de leurs êtres chairs à canon, au front ? Comment faisaient-ils sans l’humour noir, acide, mais ô combien réconfortant de Pierre-Emmanuel Barré ? J’attends mes deux minutes de rires, chaque jour, avec autant d’excitation que le gamin qui se bâfre de bonbons à la sortie de l’école.
Débrancher les écrans
Je ne cours pas pendant quelques jours, donc. Pour nous autres coureurs la course à pied est pareille à la charpente qui structure nos maisons. Le souffle du confinement fait vaciller l’édifice, comme l’ouragan qui fait voleter, en quelques secondes, la maison de toute une vie. Respecter une routine quotidienne devient compliqué. Il est aisé de se lever tard, très tard. La notion de week-end n’existe plus, et je me perds dans les jours, semblable au randonneur qui navigue à vue, sur les cimes des montagnes et dans le brouillard épais. Mardi, jeudi, dimanche ? C’est la même chose, puisque le mois de mars, chargé de compétitions, en est désormais délesté.
Le temps nous échappe, comme le judoka qui lâche la garde de son adversaire.
L’écran fait office de lien avec l’extérieur, mais il faut s’efforcer de s’en abstraire, quelques heures.
Il faut résister à l’ouragan. Le temps nous échappe, mais le temps nous appartient. C’est le temps de chacun. C’est le temps de se reconnecter à soi. Désormais, c’est yoga et/ou méditation, tous les jours. Sentir la chaleur du souffle qui parcourt le corps, se dresser dans la poitrine avant de s’élever par-delà la tête. S’affranchir du monde extérieur pour atteindre son monde intérieur. Quel apaisement.
Désormais, je tiens mon journal de bord, tous les jours. Quand la plume vogue au fil des pages, l’esprit se sent plus léger.
J’ai retiré les marque-pages de quelques livres qui avaient pris la poussière. Se replonger dans d’autres mondes que le nôtre.
Qui sont les sauvages ?
Un début de soirée le week-end dernier, je vais faire quelques courses en vélo. Quel bonheur d’appuyer sur les pédales sur quelques centaines de mètres, l’air frais qui cingle le crâne et les guiboles qui moulinent.
J’ai derechef l’air d’un martien avec mes gants en latex bleus et un masque FFTP3 (ne me demandez pas pourquoi, ma copine en avait un qui traînait) : si les symptômes sont évanouis, je suis sûrement porteur de ce virus invisible, qui en fait toute sa dangerosité.
Le supermarché est presque vide, et je n’ai donc pas à louvoyer pour respecter les distances de sécurité. Les rayons sont aux deux-tiers vides, aussi, et il n’y a, évidemment, plus de papier toilette. Souvenons-nous que nos écrans avaient diffusé des images sur lesquelles des réfugiés se battaient pour un bout de pain, entassés dans ces camps inhumains. Des sauvages, certains s’étaient esclaffés sur les réseaux sociaux.
Ces réfugiés sans prénom tentaient de survivre, l’estomac vide. Combien de sauvages, en France, en Angleterre et ailleurs, qui empilent les boîtes de conserve et les paquets de pâte, quitte à les jeter, dans quelques mois quand ils seront périmes, la peau de leur ventre qui dessinera un ovale de ballon de rugby?
Eux mouraient de faim. Notre mode de vie mortifère est notre fin.
Il n’y a plus de pâte. Il n’y plus de riz. Il n’y a plus de papier toilette. Mais il y a du roquefort (AOP, hein !), et une ou deux bonnes quilles qui traînent sur des étals vides. Hop, sur le porte-bidon.
Comme un air de Paris-Roubaix : les bras arrimés au guidon, le vélo qui sautille et les flacons s’entrechoquent sur les routes en (très) mauvais état de Manchester.
Le lendemain matin, le cerveau un peu embué et la suavité d’un ou deux verres encore sur les lèvres, les rayons du soleil sillonnent à travers les rideaux, comme le grimpeur monte les lacets d’un col, encouragés par le pépiement des oiseaux.
L’écran fait office de lien avec l’extérieur, mais il ne remplacera jamais les yeux et l’imagination.
Le confinement a le goût du renouveau.