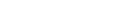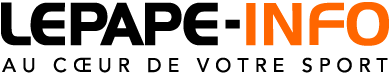Un record personnel établi quand on ne s’y attend pas… Des jours « coup de mou » qui tombent précisément le jour de l’épreuve… Coïncidences ou prédictions ? L’heure est aujourd’hui au contrôle exhaustif de tous les paramètres de la performance. En dépit de cela, rien n’y fait : la course tant attendue peut effectivement devenir un véritable chemin de croix. Ce n’est pourtant pas faute de se présenter le jour J avec ses plus belles armes : une belle économie de course, une haute VO2max, une FC qui répond bien… Bref, l’illusion d’une harmonie parfaite entre les composantes importantes de la performance en endurance. Dans ce cadre, pourquoi un tel chemin de croix peut-il malgré tout survenir ?
Bien que tous les compteurs soient au vert, c’est donc une sensation d’inconfort qui prédomine, et ce souvent dès le début de la course. Une impression anormale de pénibilité, alors que l’allure parait facile… La présence frustrante d’un décalage entre ce que l’on sent et ce que l’on fait. Certains attribuent cela à l’environnement de la course, d’autres à leur programmation d’entraînement. Pour autant tous s’accordent sur un point : ce ressenti pendant l’épreuve fait autorité sur la performance ! Une autorité que rien ne pourrait surclasser pour mieux prédire ce qu’il adviendra pendant la course…
Donne-moi ton RPE et je te dirai qui tu es.
Il n’y a pas moins subjectif que ce ressenti, et pourtant celui-ci est devenu la référence en sciences du sport – un milieu où, paradoxalement, tout doit être précis, calé, réglé. Pourquoi un tel engouement ? Tout simplement parce qu’à lui seul, ce ressenti représente la signature de l’ensemble des réactions de l’organisme intégrées par le cerveau et exprimé comme un « degré » de difficulté. En d’autres termes, c’est un repère fiable pour interpréter les douleurs ventilatoire ou musculaire, les sensations de charge mentale lors de la course, ou encore la pénibilité des ampoules aux pieds. Un ensemble d’informations qui, par l’intermédiaire de ce ressenti, devient globalement externalisé.
Mieux connu sous la dénomination de « RPE » (pour « Rating of Perceived Exertion »), ce ressenti se présente donc comme un vecteur on ne peut plus complexe. En effet, on sait aujourd’hui très bien que pour une allure de course donnée, l’effort peut être interprété comme plus dur si on est démotivé, préoccupé par ses tracas quotidiens, en dette de sommeil, malade de la veille, courbaturé, à jeun, etc. Pas besoin de la science pour pouvoir le constater.
À l’inverse, l’effort semble moins dur lorsque réalisé en groupe, porté par le public ou encore paré de sa plus belle tenue de running ! Les exemples ne manquent ainsi guère pour illustrer le décalage entre repères objectifs et subjectifs à l’exercice. Et chaque jour d’entraînement nous rappelle effectivement qu’il n’y a pas deux séances identiques, quand bien même leur contenu pourrait l’être. Pour diagnostiquer simplement l’influence de chacun de ces précédents facteurs, on pourra alors s’appuyer sur l’échelle de Borg1.
Le RPE comme une signature de l’effort.
« Maintenant, à 13km/h, je suis plutôt à RPE 14… ou peut-être 15 ». Initialement, cet étalonnage (de 6 à 20) avait été imaginé pour refléter les valeurs de FC divisées par dix. Puis l’utilisation de cette échelle au sein d’activités autres que celles d’endurance a progressivement nuancé la relation au rythme cardiaque pour étendre l’interprétation. Qu’importe donc le type d’effort, il s’agit donc toujours d’estimer un degré de difficulté. Une affaire qui reste évidemment personnelle, votre RPE 20 étant différent du mien.
Dans ce contexte, voir que la science ait finalement validé la dimension prédictive du RPE sur la performance en endurance peut alors paraître anodin. En effet, il apparaît évident qu’à mesure que grimpent les valeurs RPE, la capacité à soutenir l’exercice suive la cinétique inverse2. Une relation indissociable que l’on perçoit d’ailleurs assez bien sur les séances de fractionné, lorsque l’on a misé un peu trop haut sur l’allure de la première série, et que la suite de l’entraînement devient affaire de négociation avec soi-même… En revanche, là où il y a de la nouveauté et de l’intérêt, c’est lorsque l’on apprend que ce RPE peut s’avérer plus fiable à prédire la performance que les sacro-saintes valeurs de VO2max et de seuils ventilatoires – un résultat démontré pour le moment sur des épreuves de courtes (~6min) et moyennes (~30min) durées3. Mon ressenti ou l’outil le plus important pour ma performance ? De quoi s’y pencher quelque peu…
Adhérer à cette dernière idée reviendrait à placer, dans la programmation d’entraînement, les repères internes (sensation de chaleur, de tension musculaire, d’appuis au sol, etc.) au moins à la même hauteur que les feedbacks renvoyés par les outils du type cardio-fréquencemètre, GPS et autres capteurs de puissance. À l’heure où les objets connectés bourgeonnent, cela apparaît difficile – notamment eu égard à la fiabilité technologique de ces objets. Dans cette logique, il reste aujourd’hui moins rare d’entendre à l’entraînement « Comment je me sens à 15km/h ? » que « C’est quoi ton modèle de cardio ? ». À tort ou à raison ? La suite au prochain épisode.