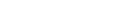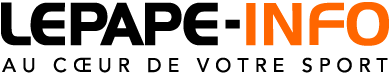Souviens toi, pourquoi tu cours ?
Actuellement en pleine préparation pour le marathon de Valence (1er décembre), je me suis noyé samedi 26 octobre lors du semi-marathon de Bordeaux. La cause ? Un trop plein d’implication qui, à l’instar du funambule, m’a entraîné dans la chute libre des (mauvaises) raisons pour lesquelles je cours.
Tu franchis la ligne du bouillonnant semi-marathon de Bordeaux, samedi 26 octobre, en 1h12’ et quelques. Ce n’est même pas ton allure marathon. Une sensation de vide intérieur, de profonde affliction, te saisit au corps. Tes poils se hérissent et ce n’est pas, ce coup-ci, en raison de la formidable clameur du public qui t’a accompagné, toi et tes 10 000 acolytes, quelques instants plus tôt, sur le Pont de Pierre.
Presque simultanément, ton œil pivote sur la gauche et tu aperçois ce podium auquel tu aspirais. Tes entrailles remuent. Tu viens de te noyer, comme cela t’es souvent arrivé par le passé.
Tu as allumé l’allumette, l’étincelle a pris mais tu as tout fait sauter. Incorrigible.
Voilà un mois et demi, début septembre, tu finissais deuxième du marathon du Médoc. Avec à peine 100 bornes par semaine. Tu t’étais dit : une décennie après mes années juniors-espoirs, je mise, derechef, (presque) tout sur la course à pied. Tu veux explorer tes limites. Le marathon de Valence sera le premier chapitre du énième tome de tes ambitions athlétiques. Une dizaine d’entraînements par semaine -120-130 km à pied, plus le vélo et la natation-, presque toujours en déséquilibre à jongler avec ton activité professionnelle. Il te faut, aussi, surtout, bien récupérer, sinon tu prendras le mur avant même le 35e. Il te faut, aussi, surtout, bien manger, pour la même raison.
Tu reprends donc l’entraînement fin septembre, après une dizaine de jours de coupure suite au Médoc. Tu as le feu intérieur. Tu les veux, ces 2h20 (allez 2h19’59’’ : une seconde, ça ne change rien ; une seconde, ça change tout). Tu te les enfonces dans le crâne.
Une tendinite, anodine, te coupe dans ton élan. Tu brûles de courir. Tu ronges ton frein. Dix jours sans lacer les runnings, ta seconde peau. Puis tu as le feu vert pour reprendre. Tu reprends. Comme le barrage qui vient de céder, ton envie te submerge. Tu devais faire 1h15 en endurance. Tu croises tes potes pendant ce footing et, sur un coup de tête, tu les accompagnes, d’abord de loin, puis de plus en plus près, sur des fractionnés de 1 minute vite – 45 secondes lent. Tu n’apprends pas de tes erreurs.
Coureur pyromane
Ton pied vient de riper sur le fil qui traverse les rives de la performance. Deux jours plus tard, ta tendinite irradie de nouveau. Tu te dis que tu as tout ruiné. Tu ne pouvais pas patienter deux ou trois jours en compensant avec du vélo ? Valence : c’est dans huit semaines. Tu as allumé l’allumette, l’étincelle a pris mais tu as tout fait sauter. Incorrigible. Tu es ce coureur pyromane qui cherche, désormais, un hypothétique canadair pour refréner ses ardeurs ; mais le vent est violent et les flammes que tu as attisées flamboient.
Alors tu te consumes, lentement, de l’intérieur. Plus grand-chose ne compte autour de toi, à part cette foutue place dans l’avion pour Valence qui risque bien d’être libre –bah oui, tu vibrionnais tellement que tu l’as payé depuis des mois, cet avion.
Tu n’as que des os à ronger : musculation, natation, aquajogging, simples ersatz pour assouvir ta soif et d’entraînement et de dépassement –tu n’es même pas en France et tu n’as pas ton vélo pour t’amuser (et t’en mettre plein la tête, comme on dit dans le jargon).
Début octobre, seul au milieu d’une piscine sans âme au cœur de l’Angleterre, tu cours pendant une heure dans l’eau. Tu croyais que nager, c’était glisser comme un poisson ; au lieu de ça, tu batailles comme une poule qui manque de se noyer à chaque battement (en plus, ils t’ont refusé le gilet de survie pour flotter, à la piscine).
Tu te demandes ce que tu fais là, dès les premières secondes. Tu continueras, pourtant. Le temps ressenti, la durée pour paraphraser Bergson, te paraîtra bien long. Tu t’imagines, alors, courir une heure dans la forêt où le temps ressenti n’a plus de prise sur tes foulées, comme pour accélérer le temps objectif –l’horloge sur laquelle les secondes se dévident.
Ton esprit, c’est ton pied
Le plaisir est donc inexistant. Dans ta tête ? Je travaille pour Valence. Je travaille pour Valence. Je travaille pour Valence. Les pensées s’amoncellent tels de lourds nuages noirs et se perdent dans les circonvolutions de ton programme d’entraînement : comment l’adapter pour ne pas perdre la moindre seconde. « Ne pas perdre » : tu te dis que ton langage, auto centré sur la seule performance, épouse la courbe de ton impatience à tous crins.
Ton esprit est ton pied. Littéralement. La nuit, un œil qui cligne, impromptu, et scrute l’état du blessé ; une main qui tâte comme le médecin qui ausculte le pouls ; tiens, c’est moins douloureux, là. Peut-être ; peut-être ? Et puis, non, les premières foulées esquissées disent la douleur. L’esprit ne sent pas les fines gouttes de pluie qui fouettent ton visage, le long de la rivière. L’esprit ne voit pas les arbres se mouvoir sous l’effet de la brise légère. L’esprit n’écoute pas les oiseaux qui chantonnent. L’esprit fait « un » avec le pied. L’esprit est le pied. Le pied est l’esprit. Tu ne sais plus. Tu souris intérieurement quand le fil de la gêne s’estompe. Tu grimaces quand l’impact au sol charrie son onde de vibration. Oscillations perpétuelles. Désolantes oscillations.
Tu te mets minable sur un week-end à vélo. 300 bornes en deux jours et demie, dont 175 en une seule journée. Hypoglycémie, la totale. Tu roules, tu fends l’air, tu brises les chaînes qui t’enserrent, tu t’exploses, tu t’amuses. Tu (re)vis, quoi.
Une nouvelle fois, tu n’écoutes pas ton corps te dire que tu vas dans le mur. Le lendemain, ton tendon rotulien te rappelle que tu en as trop fait –c’est ton propre diagnostic, en fait ; tu crois que c’est ça, tu es tellement dégoûté que tu n’as pas même envie d’aller voir le médecin, car il n’y aura, de toute façon, pas de marathon, tu en es convaincu, maintenant.
Putain, je vis !
Tu ne peux même plus aller bosser en vélo –la douleur te transperce comme ce marteau piqueur qui fracture le macadam. Ça te coûtera 40 euros de parking et de PV, ces conneries. Ta douleur au genou s’efface aussi subitement qu’elle était apparue, deux, trois jours après. Ton corps te parlerait-il ?
Tu reprends tranquille, vers le 10 octobre, avec un collègue qui débute la course à pied. 11, 12 à l’heure, tu ne vois pas le temps passer et tu te fais plaisir. Tu as l’impression que les secondes défilent plus vite, tout d’un coup.
Le pied est guéri, tu es reparti de plus belle. Un test le week-end (1h30 à 16 à l’heure), ça tient. Reste 7 semaines, allez coach, on se lâche. Mentalement, nerveusement, tu t’engages sur chaque séance. Tu as l’impression d’y jouer ta vie. Fractionné : 3 minutes – 4 min 30 – 6 min – 4 min 30 – 3 min, entrecoupés de courtes pauses. Tu t’envoies dès le premier trois minutes. Rattraper le temps perdu. Au fond de toi, tu sais bien que tu ne le rattraperas pas, mais tu aimes l’idée de te mouvoir dans cette croyance. Tu fais ta récup à 8 à l’heure. Vidé. Putain, je vis !
Bis repetita, deux jours après, sur du plus court (6 x 30 secondes vite – 30 sec lent ; 6 x 1 min vite -30 sec lent ; 6 x 30 sec vite – 30 sec lent). Tu dois juste mettre un peu de rythme et tourner les jambes. Mais tu es en retard. Ou tu le crois, car tu feins de soupçonner les pouvoirs rédempteurs du corps humain, quand il est mis au repos. Tu t’exploses le cardio dès le premier. Vaille que vaille. Tu fais ta récup à 8 à l’heure. Vidé. Putain, je vis !
Deux jours après, de retour en France, tu t’accroches aux potes sur une plus longue séance. Ça va vite, tu retrouves de belles sensations (10 min vite – 8 min vite – 20 min vite ; courtes pauses entre). Mais tu es sûrement en surrégime avec l’accumulation. Tu fais ta récup, le soir, au coucher du soleil, planté à 20 à l’heure (en vélo, hein). Mais pour une fois, tu t’en fous de l’allure. Tu es dans l’instant. Tu oublies la montre, l’allure, le temps. Vidé. Putain, je vis !
Les prémisses de la débandade
Le mardi tu remets ça, sur des 1 min rapides – 30 sec récup. Et puis le mercredi, tu te réveilles. Sonné. A cran. Au programme : 3 min – 9 min – 6 min – 3 min – 1 min. Tu sens le souffle de la fatigue sur ta nuque. L’enchaînement des séances, les reportages à écrire, ceux à proposer, les futilités administratives… Tu aimerais te propulser trois heures plus tard. Et l’instant présent ? Respire et sois dans l’instant présent ! Tu t’accroches, ça court vite, mais la tête, elle, veut s’enfuir de ton corps et se (re)poser sur le bas-côté de la route. Au final, si tu t’es fait sortir par ton pote, tu étais dans le tempo. Mais tu n’es pas satisfait de ton attitude et des pensées qui t’agitent. Tu sens les prémisses de la débandade. Les voyants s’allument.
Le vendredi, la veille du semi-marathon, tu hésites à aller courir, après une sieste de « muerte ». Ton corps te réclame un jour de repos. Le plan, c’est le plan, tu te dis. Tu as fait ce choix, presque cette promesse, de te livrer presque corps et âme pour le marathon, tu te dois d’assumer, maintenant ! Tu vas chercher ton dossard pour le semi en courant, et, au retour, les guiboles si lourdes, tu penses très fort à rentrer en tram. Mais le plan, c’est le plan, tu te répètes en boucle.
Samedi soir, jour de course. Tu espères courir à environ 3 min 15 sec au kilo (18,5 à l’heure) pour faire autour d’1h08’. Encore une fois, tu penses à la performance avant même d’embrasser la joie de courir. Tu pressens ce qui va arriver –d’ailleurs, tellement fatigué, tu as bien fait de mettre le réveil deux heures avant la course, que tu aurais pu voir dans tes rêves, autrement.
Le corps et l’esprit saoulés de bornes à haute intensité depuis 15 jours, tu ne peux t’empêcher de suivre, toutes voiles dehors dans l’euphorie ambiante, la tête de course avec qui tu frayes habituellement, alors que tous les clignotants virent, maintenant, à l’orange foncée, voire au rouge.
Résultat ? Un départ trop rapide, un point de côté et l’envie de vomir à partir du 10e (tu as mangé trop tard). Dans les derniers kilomètres, avant de franchir la ligne en 10e position, l’esprit se noie dans les abîmes de la métaphysique et cherche, désespéré, une illusoire bouée de sauvetage. Pourquoi diable je continue de courir, alors que je ne prends aucun plaisir ? Tu pleures ce que tu n’as pas. Et puis quand tu l’as, tu pleures encore car tu l’as brûlé. Le soir, tu t’interroges.
Pourquoi tu cours ?
Souviens-toi quand tu étais enfant. Fais revivre le gamin qui est dans tes entrailles. Souviens-toi quand tu gambadais, sans montre, par-delà les chemins, les cheveux aux vents, la brise sur le visage, l’odeur de la campagne, l’air polaire qui s’engouffre dans les narines, les joues glacées, le bonheur de l’eau chaude, ensuite, si réconfortant, sur ton corps et des muscles rougeoyant de froid.
Souviens-toi, quand tu quêtais la moindre bribe de motivation tout en bas du puits dans lequel tu végétais suite à un échec, et quand tu te mettais minable, seul, sans arrière-pensée, sans plan d’entraînement à respecter et sans l’impression que la terre allait craqueler sous tes pieds endoloris si tu avais ne serait-ce qu’un micro-dixième de retard sur l’allure escomptée.
Pourquoi, parfois exténué, tu enchaînes les kilomètres ? Pourquoi tu deviens tendu comme un arc à la moindre contrariété, aux trente minutes de sommeil que tu vas manquer – c’est une flèche que tu te décoches à toi-même.
Tu cours 2h, tu ne vois pas les couleurs de l’automne qui habillent tes chemins, tu ne vois pas les rayons du soleil qui percent les arbres, tu ne vois pas ton ombre danser sur la route.
Par contre, tu vois ta montre. Tu vois ton allure. Aveugle, tu ne vois que cela. Vais-je tenir ? Vais-je lâcher ? La montre. L’allure. Le temps. Tu ne sens pas tes pieds « flapper » le macadam, comme dirait l’écrivain Sylvain Coher.
Tu oublies que tu es vivant. Seul compte la séance. La montre. L’allure. Le temps.
Groggy
Le lendemain du semi-marathon, à peine réveillé, encore groggy par ton échec de la veille, tu dois te coltiner 1h45, dont une heure à 17 à l’heure. Oui, ton esprit réfléchit comme ça : « te coltiner ». T’infliger, presque. Sur le papier, tu dois être plutôt à l’aise. Mais tu ne le sens pas. Les guiboles gémissent. Le cœur et l’esprit, fatigués, t’intiment l’ordre de ralentir.
Pourquoi tu cours ? Tu manques de sommeil, tu dois récupérer. Tu le sens. Tu le sais. Restez fort dans la tête. C’est ton choix, de te préparer à fond, non ? Assume. Tu es au cœur du sujet. Tu es au corps du sujet.
Tu tentes. Tu dois être à 3 min 30 sec au kilo (17 à l’heure), tu es à 3 min 35 sec – 3 min 38 sec. Tu ne t’énerves pas. Tu te surprends. Tu sens le vertige qui parcourt les limbes de ta cervelle. La fatigue t’estoque, tel un uppercut imaginaire qui t’enverrais dans les cordes, un genou au sol, le souffle haletant. Tu sens que tu es en train de creuser le linceul dans lequel tes ambitions pédestres peuvent s’enfouir, pour de bon.
Tu changes la vue de ta montre pour ne plus être tenté de zyeuter cette satanée allure. Tu essaies de te concentrer sur ton souffle. Te recentrer. Au bout de trente minutes, tu décides d’arrêter le tempo. Tu sens que tu vas t’exploser, sinon, littéralement.
Tu finis tes 1h45, tu enchaînes les bornes, sans contrôle de ton rythme, désormais, et tu te fais plaisir, un peu, dans la douleur. Tu revis, un peu.
Tu sais un peu plus pourquoi tu cours, aussi. Tu te dis que la sortie suivante, ça serait pas mal de prendre ton ancienne Géonaute à 10 balles pour simplement avoir une idée du chrono et oublier tout le reste. La montre. L’allure. Le temps. Bon, tu ne le feras pas, mais tu es content d’y avoir pensé. Une respiration, les yeux fermés. Et pourquoi tu ne le ferais pas ?