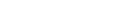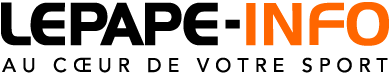La lecture des journaux se révèle parfois trompeuse. Dans les pages des rubriques sport, la compétition occupe toutes les colonnes et le haut niveau fait main basse sur tous les titres. En creusant un peu, la réalité s’avère très différente. L’amateurisme, certes, a presque disparu. Aujourd’hui, la réussite ne s’envisage pas sans une totale disponibilité de l’athlète. Une bonne chose pour Pierre Bonvin, le coordonnateur de l’athlétisme à l’INSEP (Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance) : « La ligue professionnelle d’athlétisme (LNA), la première du genre créée par une fédération pour un sport individuel, présente de nombreux avantages. Elle permet de faire vivre le sport de haut niveau ». Faut-il pour autant penser que sans la voie du professionnalisme, le haut niveau ne survivrait pas ?
La question est, bien sûr, nettement plus complexe. Il ne suffit pas de donner un salaire et un statut aux sportifs pour régler le problème. Les paramètres sont nombreux, les risques réels. Différents acteurs du sport le disent, à l’image du sociologue Patrick Mignon : « Le sport de haut niveau est fragile, mais il persistera ». D’autres, comme Christophe Falignon, bénévole dans un club d’athlétisme à Quimper et organisateur d’évènements sportifs, s’avouent pessimistes : « Les mentalités et les modes de vie de nos sociétés actuelles présentent un frein au développement du sport ».
Le facteur divorce
Les jeunes perdent-ils goût au sport et à son effort ? Pour Christophe, entraîneur d’athlétisme depuis 11 ans, le manque de motivation est réel chez les plus jeunes. Une tendance qu’il explique par l’attractivité d’activités sportives dites « plus fun », et par une perte de goût pour l’effort. « Je le vois au club, dit-il, les jeunes sont vraiment là pour s’amuser, rigoler avec les copains. Mais s’investir d’avantage pour être meilleur en compétition leur pose problème ». Les sports de sensations, comme le roller ou le skate, connaissent un beau succès chez la « génération Y », comme s’amuse à l’appeler Christophe. Une génération en manque de repères et « difficilement maîtrisable ».
 Mais pour ce passionné de sport d’endurance, le véritable problème vient de l’évolution des modes de vie : « L’arrivée des 35 heures en 2002 a fait beaucoup de mal au monde sportif et associatif. Les parents prévoient de partir en séjour pendant les week-ends au détriment du programme sportif et culturel de l’enfant ».
Mais pour ce passionné de sport d’endurance, le véritable problème vient de l’évolution des modes de vie : « L’arrivée des 35 heures en 2002 a fait beaucoup de mal au monde sportif et associatif. Les parents prévoient de partir en séjour pendant les week-ends au détriment du programme sportif et culturel de l’enfant ».
Autre facteur qui constitue un frein à la pratique : l’augmentation du nombre des divorces. Un phénomène qu’à étudié Patrick Mignon : « Les divorces peuvent perturber la vie sociale d’un enfant. Souvent, il est obligé d’arrêter son activité sportive, du moins en compétition, puisque ses week-ends sont désormais perturbés. Il s’en va rendre visite à l’autre parent ». Ce changement dans les mentalités des parents a des effets sur les enfants, les priorités de vie sont modifiées. Le sport, oui, mais dans le but de se détendre, d’en faire un loisir et seulement un loisir. Ce qui ne laisse pas de place à la compétition, qui demande une spécialisation intense et continue, donc beaucoup de temps. Des contraintes pour l’enfant et surtout son environnement. Gautier Oddo, 25 ans, ancien coureur de demi-fond reconverti au skate, n’en fait pas de mystère, il déclare : « Je suis étudiant en architecture. L’athlétisme à haut niveau me demandait beaucoup d’investissement pour trop peu de reconnaissance, tant sur le plan de la notoriété qu’au niveau financier. Du coup, j’ai fait le choix d’arrêter l’athlétisme pour un sport plus fun, le skate. Il demande moins d’engagement, car il relève plus du loisir que de la compétition ».
Le boom du sport loisir
Cédric Quignon, psychologue et spécialiste du haut niveau à l’Insep depuis 2001, constate que le phénomène ne doit rien au hasard : « Le sportif, à un moment donné, va établir une équation : le rapport coût/gain. Il va réfléchir à combien cela lui coûte de faire du haut niveau, et inversement, quel gain il en retire en terme de reconnaissance, de temps et d’argent ».
Même son de cloche pour Slim, directeur des sports à la mairie de Pierrefite (93) et bénévole dans un club d’athlétisme : « Nous constatons souvent, dans la réalisation de nos projets, que le sport fonctionne aujourd’hui à deux vitesses. D’un côté, une petite élite financée et aidée par des partenaires privés, et de l’autre le développement du sport bien-être qui touche les CSP + (Catégories Socio-Professionnelles Supérieures), au détriment du sport de masse ». Ces dix dernières années, le sport loisir, souvent associé à la détente et au bien-être, a réalisé une très forte percée dans la société. Cela peut-il nuire au sport de haut niveau ? « Oui », répond le chargé des sports de Pierrefite : « Je suis bénévole en club et je le remarque tous les jours. Les entreprises ne sont attirées que par les meilleurs et l’état subventionne seulement s’il y a un projet santé ou féminin. Mais pour l’essence même du sport, c’est-à-dire, partir en stage pour réaliser de meilleures performances, il y a un réel désintérêt », s’exaspère t-il. Un paradoxe, puisque d’un côté le nombre de licenciés ne cesse de croître dans les fédérations, de l’autre leur profil a changé. Exemple : la Fédération Française d’Athlétisme. En 2008, elle enregistre son plus grand nombre de licenciés, avec 181 116 membres, alors que les résultats de son élite ne se portent pas au mieux.
Finalement le sport/santé étoufferait-il le sport de haut niveau ? Pour Sylvain, ancien responsable marketing d’une grande marque sportive, la réponse ne fait aucun doute : « Pour une marque de sport, il est plus rentable en terme d’image de subventionner des courses sur route, plus populaires donc plus fortes en impact sur un grand nombre de personnes, qu’investir sur une élite que l’on voit rarement et qui ne représente qu’une petite partie de la société ». Associée à ce phénomène, l’intervention de plus en plus présente des partenaires privés dans le sport qui rend le sport de haut niveau encore plus compétitif et exigeant. En effet, un partenaire souhaite associer son nom auprès d’un athlète de renom ou d’un grand club (exemple : Lagardère Paris Racing), ce qui rend l’accès au haut niveau de plus en plus dur et sélectif.
réponse ne fait aucun doute : « Pour une marque de sport, il est plus rentable en terme d’image de subventionner des courses sur route, plus populaires donc plus fortes en impact sur un grand nombre de personnes, qu’investir sur une élite que l’on voit rarement et qui ne représente qu’une petite partie de la société ». Associée à ce phénomène, l’intervention de plus en plus présente des partenaires privés dans le sport qui rend le sport de haut niveau encore plus compétitif et exigeant. En effet, un partenaire souhaite associer son nom auprès d’un athlète de renom ou d’un grand club (exemple : Lagardère Paris Racing), ce qui rend l’accès au haut niveau de plus en plus dur et sélectif.
Pour Pierre Bonvin, coordonnateur de l’athlétisme à l’INSEP, le professionnalisme dans le sport de haut niveau est une bonne chose, car il permet de mieux encadrer les meilleurs, donc de s’offrir plus de chances de médailles dans les grands championnats : « Même si cela va tuer le sport de masse et poser un problème de détection et de formation », admet-il. Le problème de la détection est à prendre au sérieux car cela sous entend moins de moyens pour découvrir des talents, ce qui est plutôt contraignant si l’on veut des futurs champions et des médailles.
A l’évidence, le sport de haut niveau ne court pas vers sa mort prochaine. Il ne disparaîtra pas. Mais l’évolution de la société, et les règles du marché, l’obligeront à évoluer. Pour être toujours plus exigeant et élitiste.