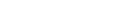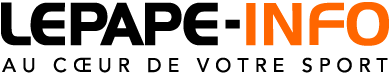C’est quand même quelque chose à vivre, un départ de marathon. Une foule immense, les entrailles qui bruissent comme le vent qui fait voleter les feuilles d’automne, les accompagnants aux petits soins. La dernière semaine, chaque moment de la journée est raccordé à la course du dimanche : les pensées sont comme arrimées au port, elles ne peuvent pas voguer, et la seule chose qui compte est d’économiser ses forces en prévision de la tempête annoncée. Les semaines de préparation, le régime dissocié qui a épuisé les réserves en début de semaine laissent place, sur la ligne départ, à l’ardente adrénaline tant recherchée : le cœur brûle et avoisine déjà les 150 pulsions par minute. Il y a toujours ce petit vertige de se lancer sur 42 km.
On y est, donc. Dix minutes à trottiner pour se rendre sur le site du départ, pas de lignes droites, mais un premier kilo en 3’10’’ (19 à l’heure), sans s’en rendre compte, sur le billard valencien, dans la foulée l’Espagnol Javier Martinez, lièvre sur 2h19’ (3’18’’ au kilo, soit 18,2 à l’heure). Ouchhh. Mettre le frein à main ? C’est tellement bon, ces sensations…Je m’étais dit que j’allais tenter. Je tente.
La course à pied est un jeu et j’ai les cartes en main. Les premiers kilomètres sont un vrai délice, à l’image de la douceur des « Arroces », ces différents types de riz qui constituent les paellas, la spécialité locale.
La densité de coureurs est affolante. Le marathon de Valence est devenu incontournable. Un bruit sourd, un « flappement » incessant, pour paraphraser l’écrivain Sylvain Coher, auteur de Vaincre à Rome, scande le macadam, au sein du large groupe dans lequel je me trouve. Je regarde le sol. Une marée de chaussures vertes et roses, siglées de la marque à la virgule, atomiques chaussons propulsant. Autour, on est une poignée à ne pas les porter. Si tu es coureur à pied et que tu n’as pas tes Vaporfly, tu as loupé ta vie.
Dopage technologique et éthique de course
Désolé, mais je préfère enfiler des chaussures « normales » plutôt que de voler en Vaporfly et réaliser un chrono que je juge fallacieux. Dopage technologique. Le marathon, c’est trouver la clé, à l’entraînement, pour endiguer la casse musculaire qui résulte des impacts répétés au sol. Les Vaporfly, c’est un perpétuel coussin amortisseur qui déjoue cette casse.
Interrogez-vous, vous qui courez : quel est votre but ? Pourquoi succomber aux sirènes du marketing à tous crins de Nike qui, en sus d’empocher des milliards de dollars (ils font ce qu’ils veulent, après tout), ne se prive pas pour soutenir et couvrir des entraîneurs-gourous qui ont la turpitude chevillée aux pieds (cf le courageux témoignage de Mary Cain, qui a dénoncé les agissements d’Alberto Salazar, patron du Nike Oregon Project et désormais suspendu quatre ans).
Je suis dans le deuxième groupe Elite féminin. Le rythme tombe, d’un coup, après les 3’10’’ du 1er kilo et le 3’12’’ du deuxième. Bah oui, on est parti trop vite. « Tu veux vraiment faire 2h18’ ? » questionne le lièvre à une Kényane. « Ok, je fais mon job, mais ne me le reproche pas après ! »
Il se replace à l’avant et nous suivons, pareils au troupeau qui entame sa transhumance vers les sommets montagneux au printemps venu.
Je suis à l’aise. Je regarde autour. Suaves sensations, semblables à la fraîcheur d’une orange locale. Mon lacet se défait au 7e. Un instant, je me dis que je vais terminer la course ainsi. Mais c’est trop risqué. Il fût un temps où ma cervelle serait devenue incandescente. « Respire, calme toi ». Dans un virage, je m’écarte sur la droite. Une dizaine de secondes de perdu mais je parviens à faire le « jump » pour rentrer sur le groupe, sans me mettre dans le rouge, me semble t-il. C’est vite oublié. Cela doit servir à ça, le yoga.
33’10’’ aux 10 km. Dix secondes de retard sur une moyenne de 3’18’’ mais dix d’avance sur 3’20’’. L’an dernier, j’étais en mode régulateur (2h24’57’’ en négativ split, après un semi très prudent). Là, Le moteur vrombit et j’enclenche les chevaux. J’ai l’impression que le monde va s’écrouler si je suis en retard ne serait-ce que d’une seconde.
Le marathon, c’est épargner pendant trente kilomètres pour toucher, éventuellement, les dividendes in fine. Là, je balance les billets de 50 balles par la fenêtre. Notre peloton, formé du second groupe des Elite femmes et de coureurs qui suivent Javier Martinez, lièvre sur 2h19’ ne cesse de se séparer puis de se reformer. J’accompagne quasi systématiquement le groupe féminin, quand le rythme s’accélère. J’ai l’impression de faire ce que je veux. C’est grisant.

Le fil se tend…
12-13 km : les premières douleurs apparaissent dans les quadriceps. Ce sont des douleurs difficiles à décrire. Elles ressemblent à des petits courants d’électricité qui font tressaillir les jambes. Elles sont inhabituelles à ce stade de la course. Je sais que ce n’est pas bon signe. Mais j’ai décidé de mettre cartes sur table. Les filles accélèrent, derechef. Le lièvre sur 2h19’ temporise. Je suis les Elite femmes –je ne veux surtout pas manquer la bonne opportunité-, calé avec Adrien Guiomar, qui fera 2h19’43’’ (en Vaporfly). Je dirige mon épargne vers un placement à haut risque.
« Ça a accéléré là, non ? », je questionne. « Oui, oui. Je suis trop con » me dit-il. « J’aurais dû rester avec le lièvre ».
On parle, je suis content d’être capable de le faire si aisément. J’envoie des bisous à Hannah, ma copine, que je vois sur le bord de la route. C’est cool, ce marathon ! Je me retourne. Le lièvre hispanique est vingt mètres derrière. J’hésite. Attendre ? Oui, mais, j’ai le feu intérieur. Je reste aux basques des féminines. Résultat ? 3’16’’ (presque 18,5) de moyenne entre les 15e et 20e km (et 32’48’’ sur le 2e 10 km). 1h09’25’’ au semi.
Le premier groupe des Elite femmes est désormais juste devant, cerné par deux caméras perchées sur des motos. Exaltant. Je me sens comme le cycliste qui pointe à dix secondes du groupe de tête et qui va rentrer…mais qui ne rentre pas.
La performance est un écheveau de fils qui s’assemblent (préparation, hydratation, conditions de course, schéma de course, etc…). Brusquement, le cordon du cardio monte. Je passe de l’aisance à la difficulté.
Je me préparais à devoir serrer les dents, tout à fait focalisé lors des dix derniers kilomètres, après que mon esprit ait vagabondé pendant trente bornes. C’est huit, neuf kilomètres plus tôt. C’est huit, neuf kilomètres trop tôt. Les pensées s’évanouissent désormais, devant l’intensité de l’effort. S’accrocher mentalement pendant presque un semi ? Un frisson me parcourt. Impossible, je vais littéralement passer par la fenêtre. La foulée se cabre, brusquement, comme le cheval qui refuse de passer l’obstacle.
Rond-point du 26e km, au niveau de la « Plaça Saragosa ». D’un coup, le fil se distend et la pelote se dévide. Le cours du bas de laine est misérable, désormais.
Assumer les risques
C’est impardonnable, un marathon. Le deuxième groupe féminin me rejoint à la vitesse grand V. Je suis en surchauffe total. Banqueroute. Je dois être à 17 à l’heure, mais le cardio ne redescend pas, lui. Impossible de se caler dans les roues, cette fois-ci. Le marathon est une épreuve de la patience.
Comme par hasard –qui n’en n’est pas un- une violente douleur me serre le ventre. L’idée de l’abandon s’immisce dans mes entrailles.
Hannah doit me donner une casquette au 26e. Je scrute les bords de la route, bondés.
Je sens que j’ai besoin d’un soutien, ne serait-ce que visuel. Les bisous ont cédé place aux contorsions du visage. C’est un peu moins glamour.
27e km. Un gros cinquante minutes de course, encore. « Enfin, si tu es encore capable de courir à 17 à l’heure, sinon ça va être bien plus » me dis-je. L’addition va être salée.
Clément Anglada me rattrape. Impossible de le suivre. Sa frêle silhouette s’éloigne, pas à pas. Je vois devant que les réacteurs de mon pote Yannick Dupouy fument sévèrement, aussi. C’est bizarre, mais ça me booste, un peu : je ne suis pas tout seul dans la même galère.
Je le rejoins au 30e kilomètre. « Je suis mort », me glisse t-il, la foulée désarticulée.
– Moi aussi, j’ai sauté il y a 5 km ! ».
Il en reste 12 km.
« Je crois que je ne vais pas finir, continue t-il.
– Je ne sais pas quoi faire ».
J’ai un doute, car mon esprit est effervescent, pareil à l’eau bouillante qui déborde de la casserole. Mais, au fond de moi, je sais que je vais aller au bout. Un peu masochiste, je veux expérimenter cette douleur du marathon. J’en avais déjà reçu les coups d’électricité lors de mon premier Médoc – mais c’était logique, je n’étais pas au top de ma forme.
« Tu as pris des risques. Tu as fait all-in avec un paire de dix. Assume et va au bout », me susurre ma Petite Voix. Au fond de moi sourd les premiers enseignements. « Cette expérience te servira ».
On court de front avec Yannick. 5 km en 17’10’’ entre les 25e et 30e km, atteint en 1h39’50’’ (toujours sur des bases de 2h20 !). Ce n’est pas si mal, ça fait toujours plus de 17 à l’heure sur le dernier 5 bornes et ça peut encore tenir. Yannick s’arrête brutalement peu après le 30e. Devant, Clément Anglada est en point de mire. Il ne doit pas être au mieux, non plus.
C’est très étrange, cette histoire. Il y a des moments où je me sens, de nouveau, vraiment à l’aise. Pas à 3’20’’ (18 à l’heure), non. Mais autour de 3’30’’ (17 à l’heure). Et puis, 50 mètres plus loin, la foulée se délite de nouveau. Et je me dis, alors, que je vais finir à 10 à l’heure.
Les doutes rejaillissent tel un geyser au 32e km. Le soleil est désormais bien réveillé, les vingt degrés se font sentir sur les zones qui ne sont plus ombragées et j’ai un gros coup de moins bien. Tel Icare dont les ailes viennent lécher les rayons du soleil. Je m’arrête marcher. Oui, je marche ! J’ai l’impression de ne plus avoir de forces, d’un coup, telle la casse moteur en sport auto. La veille, un pote journaliste avait couru son premier 10km. Pas si mal, moins de 50 minutes mais je m’étais marré, un brin moqueur, quand il m’avait dit qu’il avait marché deux ou trois fois, sur la fin.
« Cela ne m’arrivera jamais, ces choses-là ». Bah oui, tu t’entraînes 10 fois par semaine…
Je mange une datte que j’avais glissée dans la poche de mon short. J’en ai une deuxième au cas où. Je suis en nage, et je me noie. J’en ai l’habitude dans les bassins de natation, mais un peu moins en course à pied…
De l’harmonie à la cacophonie
Je repars à petites foulées et reprend un rythme autour des 15 à l’heure. « Bordel, je vais être incapable de finir ». Le truc, c’est que lâcher l’affaire à cet endroit n’est pas synonyme de libération totale, comme le prisonnier qui se voit ôter ses menottes : c’est qu’il faut revenir au départ pour retrouver ses affaires, et tutti quanti, et que je suis dans la pampa !
Hannah doit me rejoindre au 38e. C’est là où ça sera le plus dur, lui avais-dit. J’aurais besoin de soutien pour tenir les 2h20’. C’est une astuce pour briser le vertige des 42 km : saucissonner la course en différentes tranches, comme autant d’objectifs intermédiaires. Je ralentis tellement qu’elle a le temps de s’avancer au 37e. Je suis content de la voir, et en même temps déçu. Je m’étais dit, tel un automate, qu’il me resterait quatre km de douleurs quand je la verrais. Ça fait cinq, du coup…
Une pensée surgit : l’année dernière, je doublais tout le monde. Là, je me fais découper, à la manière d’un jambon pata negra. Le pire, c’est que ceux qui me débordent sont, aussi, de guingois.
C’est incroyable, quand même, le marathon. Il y a deux heures, on formait un orchestre symphonique qui martelait le macadam en cadence. Là, c’est la débandade. Chaque coureur est seul, parfois en petit groupe, et joue sa propre mélodie, dissonante, mais applaudi par un public chaleureux.
Les visages sont crispés, les corps marqués au fer rouge sur cette ligne bleue –tracée au sol et qui symbolise la distance la plus courte-, qui défile moins vite, tout d’un coup.
Je retrouve un semblant d’énergie pour finir les deux derniers kilomètres à plus de 16 à l’heure, en 2h26’41’’. Détruit, musculairement.
J’avais besoin de prendre tous les risques pour ne nourrir aucun regret. C’est une leçon très utile pour l’avenir, mais arriverai-je à la réciter sans bafouiller?